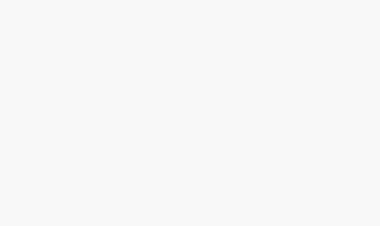Après la validation de la candidature de Wade - réflexions du professeur Alioune SALL
Si le débat autour de la candidature du Président de la République arrive à ouvrir une réflexion sur la place du Conseil constitutionnel dans notre démocratie, il aura sans doute été bienfaisant. Ce débat est important, bien sûr, mais l’opportunité doit en être saisie pour repenser l’arbitrage juridictionnel de la politique dans notre pays.

Si le débat autour de la candidature du Président de la République arrive à ouvrir une réflexion sur la place du Conseil constitutionnel dans notre démocratie, il aura sans doute été bienfaisant. Ce débat est important, bien sûr, mais l’opportunité doit en être saisie pour repenser l’arbitrage juridictionnel de la politique dans notre pays. Depuis des mois, beaucoup de choses ont été dites, en rapport avec ce débat. En soi, cette vivacité de la controverse publique est une chose stimulante, et il faut s’en féliciter. Il y a du reste fort à parier qu’après avoir été sous les feux de la rampe, puis dans l’œil du cyclone, notre justice constitutionnelle sortira de l’épreuve quelque peu transfigurée, non parce qu’elle serait dorénavant sensible aux conditionnements de la conjoncture politique, mais parce qu’à l’occasion d’un débat il est vrai tendu, elle aura compris l’espérance désormais investie en elle et l’assumera en toute clairvoyance. C’est déjà un acquis : il y aura, sans doute, un avant et un après 2012.
Mais les périodes d’effervescence sont aussi, souvent, des moments de confusion, dans lesquels les impulsions passionnelles et les inclinaisons partisanes prennent volontiers le pas sur un minimum de sérénité sans lequel le débat public n’est ni sain ni fécond. Que le raidissement du débat public soit le fait d’acteurs politiques n’est que normal, c’est même, ajouteront d’autres, le sel de la démocratie. Mais il est tout aussi légitime de chercher, au milieu de cette houle, à rappeler un certain de choses qui ont pu, il faut bien le dire, être oubliées ou occultées –on n’ose dire volontairement – dans cette controverse. Des choses qui ont pu être dites ou insinuées, certaines doivent être relativisées, alors d’autres méritent incontestablement d’être appuyées, confortées. Les faux procès ne doivent pas faire oublier les vrais défis.
Deux faux procès
Dans la fureur du débat, c’est d’abord la « clarté » et la « simplicité » qui ont été érigées en règle. La question de la candidature du Président de la République n’est certainement pas une question insoluble au regard des dispositions de la Constitution, elle y trouve sans aucun doute sa solution – nous y reviendrons -. Mais donner à penser que les normes sur lesquelles travaille le juge constitutionnel sont d’une clarté cristalline, que l’acte de juridiction constitutionnelle est un acte purement « technique », réalisable au terme d’une démarche mécanique n’est pas très sérieux. Il faut accepter la complexité intrinsèque de la justice constitutionnelle, la tenir pour irrévocablement acquise et, dans le cadre de cette contrainte originelle, travailler à faire prévaloir ses propres thèses. Dans leurs avatars extrêmes, certains points de vue entendus ont résonné à la manière d’un « Circulez, y a rien à interpréter », puisqu’il était entendu que « tout est clair ». Lorsque l’on se mêle de parler de la question en termes « scientifiques », il faut évidemment éviter de tomber dans le piège des raisonnements sommaires et des alternatives simplistes. Notre démocratie, jeune et impatiente, succombe souvent à la tentation des bipolarisations et aime à mettre en scène les oppositions spectaculaires, fracassantes, qu’il s’agisse de politique, ou qu’il soit question de l’interprétation des règles qui la régissent. Nul n’est, bien entendu, obligé de sombrer dans cette tentation. Il serait très préjudiciable que la vivacité de nos controverses emportât tout sur son passage, et que la véhémence des positions finît par déboucher sur un affaissement de toute instance critique dans notre démocratie. « Critique », c’est-à-dire, dans la mesure du possible, distante. Le seul apport d’un regard d’ « expert » sur un débat politique est de rendre fidèlement compte de ses tenants et de ses aboutissants. C’est là une exigence minimale de l’ « honnêteté intellectuelle », le débat scientifique n’est pas obligé d’être à la remorque du débat politique.
Il faut donc récuser, dans son principe même et abstraction faite des péripéties de notre vie politique, l’idée que le juge doit appliquer des « règles claires ». Au contraire, la norme qui se rapporte à la Constitution est souvent affectée de complexité, et ce pour deux raisons. La première tient à son laconisme, à la brièveté de son énoncé. Contrairement à d’autres de ses homologues juges, il n’a pas de matériau normatif abondant, et doit donc suppléer cette carence, qui est d’abord un facteur de complexité dans l’accomplissement de sa mission. La seconde raison est que la Constitution est un lieu d’oppositions, aussi paradoxal que cela puisse être. Il n’est pas rare, que dans un même texte, on trouve une chose et une autre qui tend à la relativiser. Cela ne veut pas dire que toutes les vérités se valent – car il y en a toujours une qui présente un degré de pertinence supérieur aux autres - , mais il faut intégrer cette dimension-là du travail du juge de la Constitution. Il ne sert à rien de nier cette évidence, il faut en prendre acte : il n y a pas de police du sens dans cette matière-là.
Mais cette relativité fondamentale a une conséquence que nous devons assumer : c’est que les décisions du juge constitutionnel ne sont pas des vérités révélées, qu’on peut et qu’on doit même toujours les discuter, les soumettre à la « critique » au sens premier du terme – c’est –à-dire les « juger ». La tentation est en effet grande de dire qu’une fois que le Conseil s’est prononcé, il faut se taire. Ce point de vue se nourrit, dans notre pays, d’un facteur institutionnel et d’un facteur conjoncturel : puisque les décisions du Conseil s’imposent à tout le monde, il ne faut pas les discuter, pourrait-on être tenté de dire ; et puisque le débat sur la validité de la candidature présidentielle nous a tant occupé, il est temps de le clore, ajoutera-t-on, dans la même veine. Une telle opinion est une tentative de mise au pas de la réflexion critique, elle n’est pas acceptable.
L’autre faux débat sur le Conseil constitutionnel porte sur la nécessité de n’y avoir que des « spécialistes ». Là également, on aura entendu des choses que ne corroborent ni des données scientifiques, ni l’expérience pratique de nombre de juridictions constitutionnelles dans le monde. Dans un élan qui a pu confiner au sectarisme, des juristes se sont même parfois vu exclus du débat, sous prétexte qu’ils ne seraient pas des « spécialistes ». Or, l’interprétation de la Constitution pose des problèmes transversaux qui concernent tous les praticiens du droit, quelle que soit leur « spécialité ».La réflexion sur nos institutions souffre de deux maux, le juridisme et l’académisme : penser qu’une démocratie se bâtit à coups de textes, considérer que le débat sur les institutions est un apanage.
Or, rendre la justice constitutionnelle n’est pas un exercice d’ésotérisme. Sait-on qu’il existe des pays dans lesquels, pour être juge constitutionnel, on n’a même pas besoin d’être juriste de formation, mais, par exemple, ancien député ? Sait-on qu’au Sénégal même, les universitaires présents au Conseil n’ont jamais été, depuis 1992, des « spécialistes de la Constitution », et que nul n’a trouvé à redire à la manière dont ils faisaient leur travail ?Oublie-t-on que maintes juridictions intègrent en leur sein des avocats, des magistrats et autres personnes ne se prévalant pas nécessairement d’une connaissance théorique pointue des questions constitutionnelles ? Faut-il même rappeler que c’est d’hommes de ce type que l’on attend une effectivité des normes constitutionnelles ? Ce sont les avocats, les praticiens des droits de l’homme, les gens de justice qui sont les mieux placés pour promouvoir la Constitution, parce que ce sont eux qui, dans leur pratique contentieuse, en invoquent les dispositions, en diffusent les normes dans le corps social, en demandent et imposent le respect. Ce qui fait qu’une juridiction constitutionnelle fonctionne bien, c’est l’alchimie bienfaisante qui naît du brassage des spécialités, c’est le croisement des points de vue, c’est la diversité des trajectoires : le spécialiste de la Constitution, qui apporte sa connaissance théorique et sa capacité à conceptualiser les questions posées; l’homme de justice, qui en connaît les enjeux contentieux ; l’ex législateur, qui sait saisir les ressorts des compromis rédactionnels ; l’ « activiste » des droits de l’homme, qu’habite le souci de la bonne insertion des droits humains dans la réalité… Le débat constitutionnel est donc loin d’être une affaire de caste, toute « circonscription » de celui-ci est l’indice d’une pathologie, la pathologie de l’ineffectivité. Au demeurant, la question brûlante dans notre pays, celle de la candidature du Président – occurrence qui a donné lieu au « procès en spécialisation » - ne requérait certainement pas une compétence « constitutionnelle » extrêmement aigüe pour recevoir sa réponse.
Précisons tout de même un point. L’ouverture du débat constitutionnel a une exigence minimale : c’est que ceux qui s’y expriment, à commencer par les juges constitutionnels eux-mêmes, s’intéressent à la Constitution. Les habitudes de nomination, sous nos latitudes, omettent tellement cette condition minimale que l’on en arrive, parfois, à cette absurdité consistant à nommer des gens presque contre leur gré, parce que les choses constitutionnelles ne les intéressent pas (ce qui est bien sûr leur droit). Rien ne s’oppose à ce que l’on « entende » les personnes avant de les nommer. Ni simplification outrancière de son rôle, ni procès en spécialisation donc. Mais notre juridiction constitutionnelle a certainement un vrai défi à relever.
Un vrai défi
Ce que nous sommes en droit d’attendre en retour du Conseil constitutionnel, c’est qu’il soit une institution de son temps. Dans la trajectoire des juridictions, il se produit des moments décisifs, des périodes cathartiques, où la manière de rendre la justice change, non sous le poids de la pression d’acteurs, mais sous l’aiguillon d’un nouveau contexte social ou politique. Par excellence et par vocation pourrait-on dire, c’est le juge constitutionnel, d’entre tous, qui est préposé à ce travail pionnier.
Le Sénégal a bien changé depuis 1992, date à laquelle notre juridiction a été mise en place. L’on a malheureusement le sentiment que l’instance arbitrale de notre démocratie n’a pas suivi ce mouvement, a eu tendance à concevoir sa mission de manière quelque peu statique et étriquée et, il faut bien le dire, finalement frustrante pour certains. Or, rien n’est plus nocif que ce sentiment de défiance. Le carcan des textes et la logique des compétences d’attribution ne justifient pas tout. Sur trois sujets de discussion qui ont eu lieu il y a quelque temps, le Conseil aurait pu délivrer son oracle sans nécessairement que les textes qui le régissent soient modifiés. Il en a été ainsi, aux premiers temps de l’application de la nouvelle Constitution, lorsqu’il s’est agi de choisir la procédure par laquelle le changement constitutionnel devait avoir lieu. De même, lorsqu’il a été saisi sur les lois de révision de la Conseil, le Conseil aurait pu statuer, ne serait-ce que sur la procédure utilisée, sans être entravé par une certaine conception de ses compétences. Enfin, sur la candidature présidentielle elle-même, on peut trouver à redire sur un certain nombre de choses. On en citera seulement deux.
La première a été l’évitement du débat dans la première décision intervenue. Le Conseil a, bien entendu, parfaitement le droit de considérer qu’il n y a pas lieu à débat parce qu’il n’a pas été spécifiquement saisi sur ce point. Mais alors, les articles controversés n’avaient sans doute pas leur place dans la décision rendue. Les évoquer, c’est nécessairement devoir aborder le débat noué autour d’eux, à propos de la candidature du Président. Si le Conseil a, à ce stade, une conception notariale de sa fonction, s’il estime – et rien ne l’en empêche – qu’il doit se contenter d’enregistrer seulement des candidatures, c’est encore son droit. Mais il ne peut, à notre sens, esquiver le débat sur des points que, d’une certaine manière, lui-même soulève. Si le juge s’était abstenu de se référer à ces textes, on aurait brocardé son silence, mais sa position aurait eu sa rationalité. Tel n’a pas été le cas à notre sens.
La seconde décision pose un véritable problème dans la mesure où elle subordonne la normativité de la déclaration présidentielle de 2007 à sa mise en forme « législative », ou tout au moins écrite. L’interprétation du Président n’aurait de portée s’il avait revêtu la forme d’un acte juridique écrit, semble dire le Conseil. Ce serait une curieuse manière de voir, qui poserait elle-même un double problème. De désignation d’abord, car une interprétation individuelle transformée en norme perd son caractère « individuel ». Si ce qu’exige le Conseil était fait, nous ne serions plus en présence d’un acteur interprète, mais d’une « loi » interprétative. Ensuite, ce point de vue fait question parce que derrière lui, on croit deviner le préjugé, que rien ne justifie évidemment, qu’il n y a de droit qu’écrit et que, d’une certaine manière, « les paroles s’envolent ». Or, dans des systèmes juridiques encore plus formalistes que celui dans lequel on se trouve, une portée est donnée aux « paroles » d’un homme qui occupe des fonctions importantes. Dans les relations internationales par exemple, plus d’une fois, un Etat s’est vu engagé par une expression orale d’un de ses représentants. On ne voit pas au nom de quoi les paroles prononcées par une autorité seraient juridiquement inefficaces. Le Conseil peut, dans la quête du sens du texte, « reléguer » la déclaration présidentielle, lui préférer d’autres preuves ou indices, mais il ne peut pas, pensons-nous, lui dénier toute portée sous prétexte qu’elle ne serait pas en quelque sorte suffisamment solennelle. Oui, les acteurs de la Constitution en sont des interprètes ! Non, pour faire droit, un comportement ou une déclaration n’a pas besoin, sauf exception, d’être formulée par écrit ! L’interprétation présidentielle se suffit à elle-même, elle est une interprétation normative, on ne peut pas lui substituer une norme interprétative.
Alioune SALL
Pr Agrégé de droit public et science politique
Chef du Département de droit public à l’UCAD
Avocat
sallaliounes@yahoo.fr